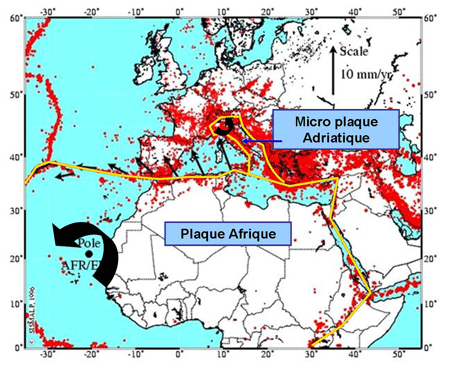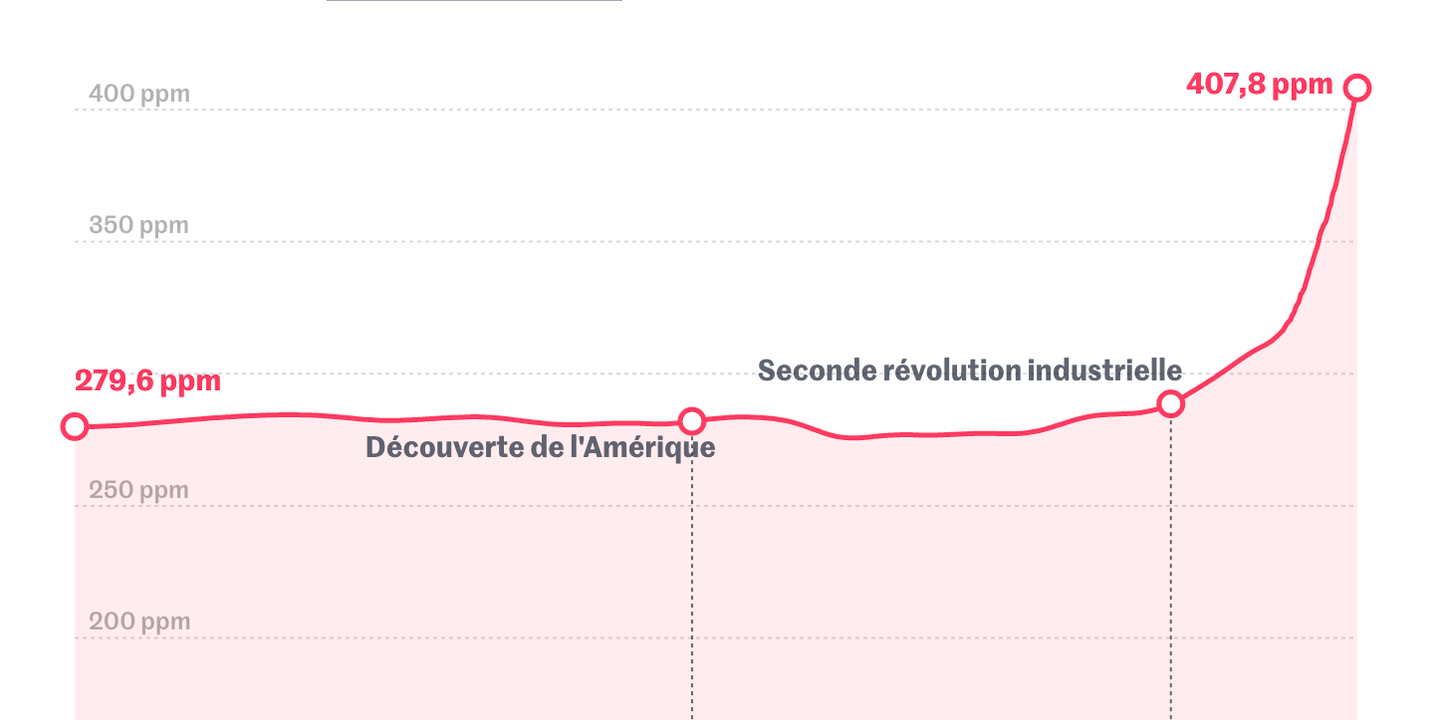- Modifié
1- La position : "après-moi, le déluge !" n'a effectivement jamais besoin d'être encouragée. Maintenant, sans même me positionner sur la problématique dont il est question, ne disposant probablement pas des connaissances nécessaires, nous oublions un peu rapidement que même en admettant un intérêt commun sur la question, les sociétés restent dans un rapport de rivalité, et sont en conséquence d'une d'une grande méfiance les unes envers les autres.
Quel pire poison que la méfiance ? Elles peuvent tout autant intriguer, même si elles acceptent la coopération, pour que les sacrifices pèsent plus sur les unes que les autres, que la cesser, et envisager des solutions moins pacifiques ou "humanistes", en considération bien évidemment de leur puissance. à mesure que le danger se précise pour certaines d'entre elles, ou pour reprendre le cas précédent, qu'elles estiment avoir été lésées par les autres
2- Rappelons également que même si les hommes peuvent témoigner de la compassion, décider des politiques de charité, un cataclysme pour les uns, n'en est pas un pour les autres : les sociétés concernées, paient l'essentiel de l'addition. Prenons le cas du séisme et du tsunami du 26 décembre 2004, et des répliques qui ont suivi : l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande… ont été immédiatement concernés, pas nous. Si pour les sociétés concernées, il s'agit probablement d'un événement encore douloureux et traumatisant, en raison de la souffrance qui en a résulté, et des sacrifices consentis pour réparer les dégâts ; pour les autres, il s'agit d'un événement dramatique lointain, peut-être même oublié.